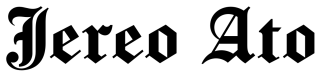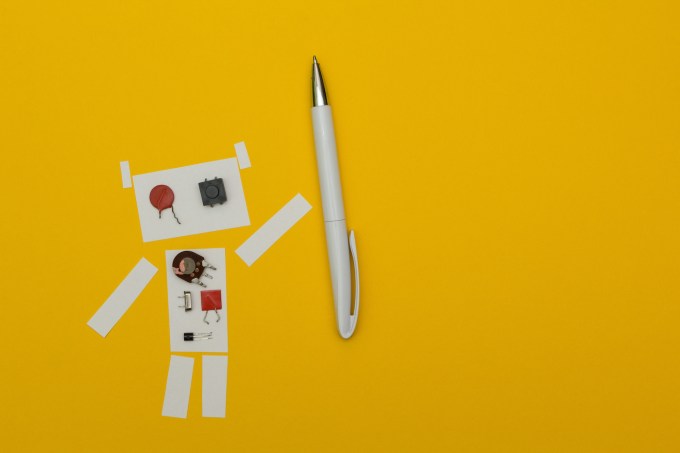Par Samuel Chalom
« Avant cette période d’inflation, pour les denrées alimentaires, je pouvais me permettre d’aller vers du bio et de l’écoresponsable, se souvient Nassim, 31 ans, formateur pour adultes à Chartres (Eure-et-Loir). Aujourd’hui, je dois faire un compromis entre le rapport qualité-prix et des choix éthiques, en me tournant davantage vers des enseignes low cost comme Lidl ou Aldi. » Le cas de Nassim est loin d’être isolé : alors que l’Hexagone a connu une inflation à 5,9 % sur un an en avril – après 5,7 % en mars – (Insee), beaucoup de Français sont contraints de revoir leurs habitudes de consommation, en rognant sur certaines dépenses… ce qui n’est pas toujours compatible avec une logique d’achat respectueuse de l’environnement.
La récente dégringolade du bio en est sûrement le symbole le plus marquant. Les ventes de produits labellisés agriculture biologique ont enregistré en 2022 un recul de 7,4 % dans la grande distribution. Les enseignes spécialisées ont également fait les frais du contexte inflationniste provoqué par la guerre en Ukraine : le leader historique, Biocoop, a fermé l’an dernier une quarantaine de ses 700 points de vente. La chute globale de l’alimentation bio devrait se poursuivre cette année avec -5,3 % anticipée par le cabinet NielsenIQ.
Les données de l’enquête « Tendances de consommation » que le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) dévoile en exclusivité pour « Les Echos START » vont dans le même sens : le taux de consommateurs de produits issus de l’agriculture biologique est passé de 64 % à 57 % entre juillet 2021 et mars 2023, et même de 74 % à 62 % pour les 18-34 ans sur la période.
« En mars 2023, la première raison de non-consommation de produits bio est le prix, pour 49 % des personnes qui n’en ont pas consommé. Cet argument rassemble plus de non-consommateurs qu’en 2019, où 36 % des non-consommateurs évoquaient le prix. A l’époque, cet argument prix faisait jeu égal avec le fait de ne pas voir l’intérêt de consommer de produits bio », indique la directrice générale du Crédoc, Sandra Hoibian.
Lire aussi :
Top 5 des métiers qui recrutent et qui sont utiles pour la planète
Sauver la planète en transformant son entreprise de l’intérieur, c’est possible !
Inflation ou pas inflation, le prix a toujours été un caillou dans la chaussure de la consommation écoresponsable, rappelle Jérémie Piquandet, directeur du planning stratégique au sein du cabinet d’études Kantar. « Plus qu’ailleurs dans le monde, les Français jugent que consommer plus responsable, plus éthique, va forcément leur coûter plus cher », analyse cet expert. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas… Par exemple, pensez friperie versus vêtement neuf.
Autre exemple : la consommation de viande. Près de six Français sur dix déclarent consommer moins de viande qu’il y a trois ans (Réseau Action Climat et Harris Interactive, mars 2023). Ce choix est majoritairement motivé par l’inflation : 58 % des personnes interrogées déclarent manger moins de viande pour faire des économies.
Un changement d’habitude profitable à la planète, du fait que l’élevage engendre une surconsommation d’eau, une part importante de nos émissions de CO2, de la pollution des sols et de la déforestation. Cependant, la préoccupation environnementale n’arrive qu’en quatrième position des raisons citées par les Français (35 %) pour en consommer moins, à égalité avec le bien-être animal (35 %) et derrière les considérations autour de la santé (37 %).
Vincent, 33 ans, conseiller en création d’entreprise à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), a lui réduit depuis plusieurs années la place de la viande dans son alimentation. « Mais je me rends bien compte, d’autant plus aujourd’hui, que cela me permet de réaliser de véritables économies, ce que je constate aussi en mangeant moins de produits transformés. »
Le paradoxe
L’inflation et les difficultés économiques, le secteur du prêt-à-porter est également aux premières loges pour les ressentir – avec des enseignes comme Camaïeu ou San Marina qui ont mis la clé sous la porte -, mais avec des conséquences paradoxales. D’un côté, l’inflation profite à l’achat de seconde main. Farah, 27 ans, avocate en banlieue parisienne, peut en témoigner : elle s’habille essentiellement dans les boutiques solidaires et les friperies et ce, « depuis déjà bien longtemps ».
Ce qui est nouveau ? Jusque-là, les achats d’occasion s’ajoutaient aux achats de produits neufs, fait remarquer Sandra Hoibian, du Crédoc. « Désormais, avec l’inflation, l’occasion se substitue au neuf pour des catégories de produits comme les objets de décoration ou les produits pour enfants », poursuit la directrice.
D’un autre côté, la hausse des prix peut aussi pousser les consommateurs vers de l’« ultra fast fashion », moins chère, mais produite à l’autre bout du monde, avec assez peu d’égards pour son impact sur l’environnement et les conditions des travailleurs des usines ou ateliers auxquels elle sous-traite la production. En témoigne le succès du géant chinois en ligne Shein : l’ouverture d’une boutique éphémère début mai à Paris a provoqué autant de files d’attente monstre… que de vives critiques renouvelées sur son modèle.
Lire aussi :
Pourquoi y a-t-il de l’inflation ? Et est-ce que c’est grave ?
« Profitflation » : les industriels se servent-ils de l’inflation pour gonfler leurs marges ?
Autre exemple, sans doute encore plus contre-intuitif : le train. Cinquante-sept pour cent des Français jugent que la première mesure à instaurer pour les pousser à prendre davantage ce mode de transport serait de rendre ses tarifs plus attractifs (Réseau Action Climat et Harris Interactive, avril 2023). « Mais cela n’a pas empêché le train de décoller ces derniers mois, tient à nuancer la directrice générale du Crédoc. Ainsi, les voyages en train ont dépassé leur niveau d’avant-Covid, tandis que les départs en avion n’ont pas retrouvé leur niveau de 2019, même s’ils sont en hausse. » Tout ça dans un contexte où les tarifs des billets de train ont augmenté de 12,7 % entre 2021 et 2022 (Insee).
Consommer local
En tout cas, s’il est un mouvement qui ne connaît pas la crise, c’est bien celui du consommer local, même s’il n’en est encore qu’à ses balbutiements, relève Hélène Rives, responsable industrie, distribution et consommation au sein du cabinet de conseil PwC France et Maghreb. « Ce sont souvent des produits durables, de saison et pas forcément plus chers », fait remarquer l’experte.
Et là où le bio et le vrac séduisent surtout certains pans de la population (aisés et seniors pour le bio, ruraux pour le vrac), le local transcende « le sexe, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle ou l’endroit où l’on vit », souligne une note de la Fondation Jean-Jaurès parue en janvier dernier. Mais attention, qui dit « local » ne dit pas forcément « vertueux ». L’occasion de souligner que le marché du commerce équitable tient bon malgré le contexte inflationniste : +7 % de ventes pour les produits équitables labellisés Fairtrade-Max Havelaar pour 2022 (contre +21 % cependant en 2021).
Le vrac, arme anti-inflation ?
Sur 900 enseignes spécialisées dans le vrac, 166 ont fermé en France en 2022 contre une cinquantaine en 2021, selon l’association Réseau Vrac. Comme le bio, le vrac est lui aussi touché par la baisse du pouvoir d’achat des Français. Pourtant, il peut se révéler une vraie arme anti-inflation : en choisissant la juste quantité de produits dont on a besoin, on gaspille moins et on économise de l’argent. En outre, le vrac peut revenir moins cher au kilo : vous paierez par exemple de 5 à 15 % moins cher à Carrefour si vous choisissez l’option vrac plutôt qu’un produit emballé, et 10 % en moyenne moins cher à Monoprix.
Samuel Chalom