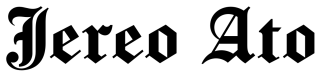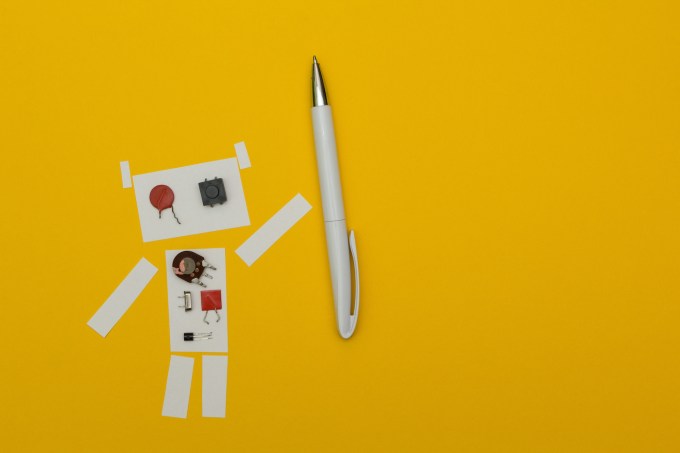Par Florent Vairet
Aux « Echos START », on reçoit tous les jours des communiqués de presse de petites marques présentant leur produit génial 100 % biosourcé, recyclé ou upcyclé… et souvent onéreux. Mais peu importe, elles ont l’assurance que quelques sincères écolos se jetteront dessus sans tergiverser. Ces start-up changent-elles la face du monde ? Hélas, le gros du commerce ne se fait pas ici. Les marques mondiales s’adressent à des marchés un million de fois plus grands, peuplés de consommateurs au budget contraint. Pendant des décennies, elles ont réussi à les attirer grâce à une méthode : la délocalisation et l’écrasement des prix. Problème, avec les années, on a compris que ce modèle se faisait tantôt sur le dos de la nature, tantôt sur celui des humains, voire les deux à la fois.
Dans cette course à la compression des coûts, le carbone a été notre ami. Ça s’est d’abord appelé charbon, puis pétrole, tous deux ayant la bonne idée d’exister en abondance et d’être énergétiquement terriblement efficaces. « Depuis l’après-guerre, l’expansion économique s’est faite grâce à une utilisation intensive des énergies et matières premières afin de fournir des biens de consommation de plus en plus abordables », résume Jean Moreau, associé au sein du cabinet BCG, fin connaisseur de la mondialisation. Quand on prend conscience que l’abondance est un mythe et la destruction de la nature une réalité, le paradigme devrait alors changer.
« La grande distribution est un frein à la transition écologique »
Mais ça ne se passe pas comme ça. Ou, en tout cas, pas assez vite au vu des conclusions toujours plus alarmantes des rapports du Giec et des catastrophes écologiques qui s’accumulent. Pendant ce temps, les rayons de nos supermarchés continuent de se remplir de produits néfastes pour la santé et ravageurs pour l’environnement. Et nous, de les acheter. Evidemment le moins cher possible, car nous voulons de moins en moins dépenser pour nous alimenter (35 % de nos dépenses en 1960, contre 20 % en 2014, selon l’Insee).
Résultat : la grande distribution représenterait 15 % de l’empreinte carbone d’un Français, selon une récente étude du Réseau Action Climat (RAC), qui fédère 27 associations impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique (WWF, France Nature Environnement, Zero Waste France, Reses…). En 2023, aucune enseigne n’atteint la moyenne de leur baromètre sur l’accès à l’alimentation durable et la lutte contre le réchauffement.
En cause, des publicités incitant toujours à acheter de la viande – responsable de l’essentiel des émissions liées à l’alimentation, et 92 % des plats préparés vendus dans les grandes surfaces sont à base de viande ou du poisson – au détriment de produits plus durables. Par exemple, moins de 10 % de la viande vendue dans les rayons est certifiée bio, toujours selon cette étude. « La grande distribution est un frein à la transition alimentaire », assène sans détour Benoit Granier, responsable alimentation au RAC. Il dénonce – dernière étude de 2019 de l’UFC-Que choisir à l’appui – la pratique des surmarges pour les produits bio, décourageant ainsi la démocratisation de ces produits.
Le chiffre
24 %
Part de l’alimentation dans l’empreinte carbone des Français
Alors, pourquoi les enseignes ne prennent-elles pas le virage de la transition ? Parce que « ce n’est pas une transition, mais une révolution que l’on doit faire », estime Matthieu Glachant, professeur d’économie de l’environnement et de l’énergie à Mines Paris-PSL. La grande distribution s’étant construite en même temps que l’intensification de l’agriculture et le développement de l’industrie agroalimentaire, faire sa transition reviendrait à changer radicalement de modèle.
Concrètement ? L’expert du BCG explicite : « Passer vers un modèle durable et accessible pour la majorité des consommateurs implique de repenser intégralement les produits et les business models en tirant parti des dernières technologies disponibles, pour être plus frugaux mais aussi plus performants. » Problème, reconnaît l’expert, cet investissement implique une augmentation des prix des produits, une direction peu envisageable au vu de notre contexte inflationniste.
« Aujourd’hui, pour faire perdurer leur modèle dans un système ultra-compétitif, les enseignes n’ont pas d’autre choix que d’optimiser toujours plus les coûts et de faire des promotions », abonde Charlie Brocard, chercheur en politiques alimentaires à l’Iddri, un think tank lié à Sciences Po Paris. Selon lui, si les enseignes sont si frileuses de s’essayer à de nouveaux produits plus durables, parfois plus chers, c’est que le risque de pousser le client chez le concurrent est trop grand ou qu’elles n’ont pas envie de rogner sur leur marge. « Et le problème est que la grande distribution n’est soumise à aucune obligation en termes de rayonnage de produits durables ! » déplore le chercheur.
Notons toutefois que la loi climat impose que 20 % de la surface des supermarchés soit consacré à la vente de produits en vrac d’ici à 2030. Une obligation qui a déjà fait monter au créneau la grande distribution.
L’inflation, ennemie de l’écologie ?
L’inflation du prix des produits de grande consommation a atteint en avril près de 15 % sur un an, selon l’Insee. Bruno Le Maire veut casser cette spirale inflationniste et a annoncé que le « trimestre anti-inflation », opération commerciale dans le cadre de laquelle les supermarchés s’engagent à vendre une sélection de produits au « prix le plus bas possible », allait être prolongé au-delà du 15 juin.
Voilà pour les distributeurs. Côté producteurs, le problème est que produire propre coûte plus cher. Les causes de cette « prime au vice », comme l’appellent certains, s’expliquent par l’absence – partielle ou totale – de taxe sur les dégâts environnementaux causés durant la fabrication de produits, les fameuses « externalités négatives ». On abîme un bien commun (air, océan, etc.) sans en payer le prix. « Sans taxe dissuasive, l’industriel n’a aucun intérêt à réduire son externalité négative, explique l’économiste Matthieu Glachant. Mais ce coût non assumé est en réalité reporté dans le temps, qu’on paiera plus tard sous forme de crise écologique… ou qu’on fait payer tout de suite, mais aux Chinois ou Indiens qui produisent pour nous. »
Plus de deux fois plus de vêtements vendus que dans les années 1980
Ce qui est vrai sur l’alimentation l’est tout autant sur le textile. « L’invasion du low cost s’est accompagnée d’une explosion des externalités négatives due à l’envolée des volumes de production », tempête Julia Faure, cofondatrice de la marque responsable Loom, également à la tête du collectif d’entreprises En mode climat. Selon Refashion, l’éco-organisme du secteur du textile, 3,3 milliards de vêtements ont été vendus dans l’Hexagone en 2022. C’était 1,4 milliard dans la France des années 1980. Une augmentation de 135 %, alors que la population n’a augmenté que de 18 %.
« Pour avoir les prix les plus bas, on délocalise dans des pays où les gens ne vivent pas dignement de leur salaire et où on peut détruire l’environnement. J’ai pu voir au Bangladesh des usines qui n’utilisaient pas les stations d’épuration et qui rejetaient directement dans la rivière leurs eaux polluées afin d’économiser des coûts », témoigne Julia Faure, lauréate du Top 35 des « jeunes leaders positifs » des « Echos START » et de Positive Planet, qui doit prendre la coprésidence du mouvement Impact France le 24 mai.
Face à ce tableau noir, difficile de ne pas jeter l’opprobre sur tout le monde économique. Pourtant, des entreprises agissent, et pas seulement des start-up. Certes mal notée mais arrivée première du baromètre du Réseau Action Climat, l’enseigne Carrefour dit être pleinement mobilisée pour la transition écologique. En 2022, elle a réalisé 5,7 milliards d’euros de vente sur les produits durables. Et s’est fixé l’objectif de 8 milliards d’ici à 2026.
Pour l’atteindre, Carrefour s’appuie sur les certifications internationales, comme le label ASC censé assurer une production de poisson d’élevage plus respectueuse de l’environnement. Ou le MSC, qui labellise déjà 50 % des poissons sauvages capturés et vendus par l’enseigne. Pourquoi ne pas aller au-delà ? « C’est un problème de disponibilité de ces poissons labellisés », assure Bertrand Swiderski, directeur de la politique RSE du groupe. Autrement dit, ne vendre que la pêche durable ne suffirait pas à répondre à la demande de poissons des consommateurs. « Or, le job de la grande distribution reste de nourrir la population », insiste-t-il.
Idem sur la pomme de terre. Carrefour a supprimé les produits antigerminatif après récolte pour les patates cultivées directement par l’enseigne, lesquelles représentent 35 % de ses ventes. « Quant à celles vendues en magasin mais relevant d’autres marques, on ne peut pas agir directement, explique le responsable. Pour autant, nous continuons de les acheter car on ne peut pas ouvrir un supermarché sans pommes de terre. » Et d’ajouter : « Ceci étant dit, nous travaillons à faire évoluer les autres marques, mais la conversion en agroécologie prend du temps ! »
La clé : moins de viande, plus de végétal
De son côté, le groupe L’Oréal dit aussi mettre les bouchés doubles. D’ici à 2030, 95 % de ses ingrédients seront « biosourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires », contre 61 % aujourd’hui. « En ce qui concerne la vitamine C utilisée par exemple dans les sérums pour la peau, nous travaillons depuis 2020 pour avoir une vitamine biosourcée, dont le maïs d’origine est sourcé durablement en Europe, à proximité du lieu de production de la vitamine C, mais également produite grâce à un procédé 100 % éco-respectueux », explique Anna Colonna, directrice générale de la recherche avancée chez L’Oréal, qui a fait de la chimie verte et des biotechnologies des alliés pour booster la durabilité de ses produits.
Autre exemple, autre pays : Lidl Allemagne serait lui aussi bien engagé dans la transition, selon Charlie Brocard, de l’Iddri. « L’enseigne a une stratégie poussée vers une baisse des produits d’origine animale au profit de ceux d’origine végétale. Or, en termes d’alimentation durable, réduire la consommation de protéines animales est le premier levier d’action ! »
« Je pense qu’on est sur la bonne voie. Pour autant, est-ce que le changement amorcé par la grande distribution est assez rapide face à l’urgence ? Non », reconnaît sans ambages Bertrand Swiderski, de Carrefour. Dans cette révolution, le changement doit se faire à deux, justifie-t-il. « À Carrefour, nous voyons cela comme un tango ; le meneur doit diriger la danse sans trop s’éloigner de son partenaire. » Autrement dit, si le consommateur n’est pas prompt à suivre les changements impulsés par l’enseigne, c’est un coup d’épée dans l’eau. Il donne l’exemple de la consigne. « Quand nous montons ce type de projet, il fonctionne, mais pas aussi bien qu’imaginé, alors que la volonté du client est là, que c’est moins cher et plus écologique. » Entre la volonté et l’action, il y a souvent un écart.
Le consommateur est égoïste
L’autre exemple typique de ce décalage entre durabilité et intérêt du consommateur est l’eau. Auparavant, on la prenait au robinet. Pas de transport par camion ni de déchets plastiques. Puis on s’est mis à l’acheter en bouteilles de 1,5 litre, puis en bouteilles de plus petite taille. « Portionnalité », portabilité, on y gagne sur tous les fronts, sauf pour l’environnement, mais le consommateur s’en fiche.
Est-il à ce point égoïste ? Oui, répond en substance Olivier Dauvers, auteur du blog Le Web Grande Conso. « Le consommateur choisit le bio ou l’option durable d’abord pour protéger sa santé, avant la planète ! Pour vendre du bio, il faut donc communiquer sur les bénéfices pour la santé, avant ceux pour l’environnement. » Sans cela, rien ne servirait de commercialiser des produits durables si seuls 5 % des consommateurs les plus sensibilisés passent à l’achat, estime Jean Moreau, qui résume la situation ainsi : « Un produit green qui ne se vend pas est inutile. »
Le consommateur, responsable de l’immobilisme ? Le Réseau Action Climat s’inscrit en faux et pointe la responsabilité des enseignes qui continuent de pousser le consommateur vers des produits les moins respectueux. « Entre le choix des têtes de gondoles remplies de produits à bas prix, les surmarges sur le bio et les labels trompeurs comme celui ‘Haute Valeur Environnementale’, dont la pertinence a été remise en question par la Cour des comptes, les facteurs ne manquent pas pour relativiser la responsabilité de la grande distribution », martèle Benoit Granier.
De son côté, Carrefour assure faire des choix audacieux. Dans le rayon cosmétique de tous les magasins par exemple, les premiers produits mis en avant sont les cosmétiques solides, dont l’impact sur l’environnement est plus faible. Quitte à perdre des clients désarçonnés par un changement d’habitude ? « Sur ce type de produit à la rentabilité moins importante, il ne faut pas en avoir 10.000, mais il en faut ! », assume le directeur de la RSE du groupe.
La solution : la déconsommation ?
Et sur le textile, comment sortir de l’impasse ? Certains avancent l’option recyclage à grande échelle comme la panacée. Mais Julia Faure n’y croit pas une seconde. « Aujourd’hui, moins de 1 % de la production de vêtements est recyclée. Si on arrive à 3 %, ce sera le bout du monde. Cela nécessite des processus industriels très complexes et coûteux. Sans compter que produire un vêtement en vue de le recycler peut conduire à un produit de mauvaise qualité, par exemple en renonçant aux ‘points d’arrêts’ (une sorte de couture renforcée) car ils sont des ‘perturbateurs’ de recyclage. »
Pour elle, une seule solution si on veut rentrer dans les clous : produire moins et rallonger la durée de vie des produits. Une déconsommation qui peut surprendre certains mais pas Matthieu Glachant, l’économiste à Mines Paris-PSL : « Les rapports du Giec prédisent une telle horreur à l’horizon 50 ans, que la décroissance s’imposera à certains secteurs. »
De leur côté, les partisans du progrès technologique veulent croire que les rayons pourront se verdir à production constante. Le cabinet BCG observe depuis dix ans une explosion de l’usage de la biologie de synthèse, qui aidera de plus en plus à produire des matières moins chères et plus durables sans recourir à la chimie classique ou aux animaux, à l’instar du lait de synthèse ou de ce qui est fait chez L’Oréal dans la cosmétique. « Pour cela, il faut engager immédiatement des investissements ciblés en R&D pour qu’ils portent leurs fruits dans la décennie 2030 », tance Jean Moreau.
Quoi qu’il en soit, pour verdir nos rayons, tous ou presque s’accordent à dire qu’il faudra en passer par la régulation. A l’image de l’industrie automobile qui s’est vu interdire par l’Europe la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035.« En termes de régulation, le Danemark a par exemple accompagné dès 1987 les distributeurs dans la promotion du bio, en coalisant l’industrie et la distribution au sein d’un conseil de l’alimentation biologique. Et les résultats sont là : en 2021, la part du bio était de 13 %, contre 6,6 % [et moins de 5 % en 2022, NDLR] en France », ajoute Charlie Brocard, de l’Iddri. Les objectifs pourraient prendre la forme de quotas de bio (comme pour le vrac) ou de rééquilibrage entre protéines végétales et animales.
La révolution ne se passera pas non plus sans une stimulation de la demande pour les « bons » produits, via des campagnes publiques pour expliquer les bienfaits du bio. « Il faudra aussi un soutien financier aux agriculteurs efficace. Et sur ce sujet, le compte n’y est pas. » Les aides de la politique agricole commune que la France consacre à l’agriculture bio ne sont pas à la hauteur des objectifs qu’elle s’est fixés, assénait la Cour des comptes dans un rapport de juin 2022. Pour rappel, l’objectif est d’avoir 18 % de surfaces agricoles bio en 2027, contre 13 % en 2021.
La baisse du bio
La décrue des ventes en bio, en partie due à l’inflation, a entraîné la fermeture d’un peu plus de 200 magasins durant l’année 2022. Par conséquent, selon le ministère de l’Agriculture, la même année, 3.380 fermes ont cessé leur activité en bio (35 % sur un an). Ce qui représente 6 % du total des fermes biologiques.
D’autres plaident pour des mesures carrément coercitives, comme un encadrement des marges de la grande distribution. Impossible ? « De telles obligations ont déjà vu le jour, comme la hausse du seuil de revente à perte par la loi Egalim, obligeant les enseignes à réaliser une marge minimale de 10 % sur les produits alimentaires », pointe Benoit Granier, du RAC.
Du côté du gouvernement, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, a annoncé le 17 mai une enveloppe de crise de 60 millions d’euros pour soutenir les producteurs bio. Surtout, il s’est engagé à faire respecter, d’ici à la fin de l’année, le quota de 20% de produits bio dans les cantines d’Etat. Rappelons toutefois que ce quota avait déjà été fixé pour 2022 (par la loi Egalim de 2018), mais le chiffre plafonne à ce jour à 6%.
Interdire l’importation des jeans de moins de 45 euros
Pour Julia Faure, il faut une loi qui pénalise le modèle économique de la fast fashion. Elle propose d’interdire l’importation d’un vêtement à un prix cassé. « Si on considère que la réparation d’un jean coûte 15 euros et que le seuil psychologique d’un recours à la réparation correspond à un tiers du prix du produit neuf, on pourrait interdire l’importation de jeans de moins de 45 euros. » Elle soutient aussi l’idée actuellement d’un « Eco-score » ou « Planet-score », qu’Emmanuel Macron a appelé de ses voeux le 16 mai dernier lors de son discours sur l’industrie verte, pour évaluer les dégâts humains et environnementaux, ce qui pénaliserait des marques pointées du doigt, comme Shein.
L’autre option à long terme est la monétisation des externalités négatives, via la mise en place d’une comptabilité extra-financière. Les entreprises devraient alors intégrer les dégâts sociaux et environnementaux dans leur résultat comptable.
« A plus court terme, une solution serait de publier les résultats des entreprises minorés de leurs émissions de CO2, valorisées au prix de la tonne de carbone », avance l’expert de la consommation Olivier Dauvers, également directeur du think tank Agroalimentaire des « Echos ».
Alors, irons-nous bientôt vers un monde 100 % écologique ? Peut-être. Mais point trop d’illusions, tant sur la vitesse que sur le but. La notion même de neutralité totale d’un produit est à prendre avec des pincettes. « Produire, c’est polluer », conclut Julia Faure. Autrement dit, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
Les lois vertes qui veulent transformer la grande distribution
# Loi Egalim (2018) :
– Elle impose depuis le 1er janvier un minimum de 20 % de produits bio dans la restauration collective. Pour l’heure, on serait autour de 6 %.
– Depuis 2019, elle impose le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires.
# Loi Anti-gaspillage (2020) :
– Réduire de 50 % le nombre de bouteilles en plastique à usage unique d’ici à 2030.
# Loi Climat (2021) :
– 20 % de la surface de vente consacrée aux produits en vrac, uniquement dans les centres commerciaux et magasins dont la superficie dépasse 400 m².
– Interdiction d’utiliser des emballages à usage unique contenant des polymères et copolymères.
– Planet-score obligatoire d’ici à 2025.
# La directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, 2023) :
– Elle impose dès 2024 aux grandes entreprises un reporting extra-financier. Elles devront publier les incidences de leurs activités sur la population et le climat, et la manière dont les questions de durabilité (sociale, sociétale et environnementale) influent sur le fonctionnement de l’entreprise.
Florent Vairet