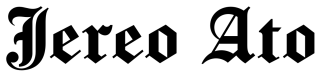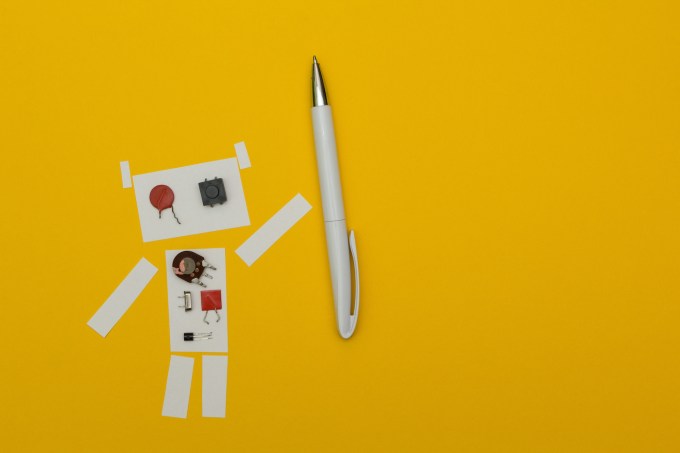Un deuxième pilier de pension durable devrait pouvoir combler l’écart entre la pension légale et la facture de la maison de retraite. L’objectif du gouvernement – mettre de côté 3% du salaire brut pour un régime de retraite complémentaire – est tout sauf évident en ces temps économiques difficiles, mais par principe de précaution, nous devons nous préparer à la retraite.
Second pilier ?
Le second pilier est la pension complémentaire que vous vous constituez par votre travail, en complément de la pension légale. Il existe deux systèmes principaux : les dépôts dans un régime d’assurance collective ou dans un fonds de pension, selon l’entreprise et le secteur. Les dépôts proviennent principalement de l’employeur et font donc partie de la rémunération globale.
Que dit l’accord de coalition à ce sujet ?
« En ce qui concerne le deuxième pilier des pensions, l’objectif est de le généraliser davantage. Dans un premier temps, l’harmonisation entre les ouvriers et les employés dans le domaine de la pension complémentaire doit être menée à bien », peut-on lire à la page 23 de l’accord de coalition 2020.
« Dans le même temps, les partenaires sociaux sont invités à réfléchir à la manière dont chaque salarié peut être couvert dans les meilleurs délais par un régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d’au moins 3% du salaire brut. »
L’accord de coalition stipule ainsi :
- Que tout le monde devrait avoir accès au second pilier.
- Et fixe un objectif d’au moins 3% de la rémunération brute.
Quelle est la situation actuelle ?
De nombreux travailleurs n’ont pas de second pilier ou ont un second pilier dont le niveau de cotisation est insuffisant pour atteindre l’objectif du gouvernement :
- La cotisation moyenne des travailleurs bénéficiant de plans du second pilier conclus dans le cadre de conventions collectives est d’environ 1,5 % du salaire. C’est donc la moitié de l’objectif minimum.
- Environ 3 travailleurs sur 4 sont confrontés à l’insuffisance du second pilier.
Quelle est l’ampleur du défi ?
La tâche qui attend les partenaires sociaux n’est pas facile, alors que les indexations se succèdent et que le handicap salarial vis-à-vis de nos pays concurrents s’accroît à nouveau. Le débat sur un « saut d’index » revient en force pour maîtriser les coûts salariaux.
Par conséquent, l’objectif fixé dans l’accord de coalition peut difficilement être qualifié de réaliste par les temps qui courent, surtout s’il doit être de 3% en plus de l’indexation. En outre, ces cotisations de retraite complémentaire ne se traduisent pas par un pouvoir d’achat immédiat pour ceux qui en ont besoin aujourd’hui.
Mais pourquoi une contribution de 3% est-elle absolument nécessaire ?
Même si de nombreux retraités sont encore très bien lotis dans les premières années de leur retraite, il faut, en vertu du principe de précaution, être prévoyant et penser aux derniers jours avec des coûts de santé plus élevés. La pension unique d’un travailleur classique est dans presque tous les cas trop faible pour payer une facture de maison de retraite de 2.000 euros.
Il est clair qu’un capital supplémentaire conduisant à une conversion d’un intérêt mensuel de 500 euros par mois est un minimum absolu. De ce point de vue, une contribution de 3% est nécessaire si l’on veut combler l’écart entre la pension légale et la facture de la maison de retraite.
Existe-t-il bien une pension minimale de 1.500 euros ?
Le montant de 1.500 euros de pension nette (à carrière complète), un des principaux objectifs du gouvernement actuel, sera certainement atteint en 2024 avec les indexations actuelles. Mais d’un autre côté, la facture des maisons de retraite augmente également, les coûts croissants étant répercutés sur les résidents.
Le relèvement de la pension minimale légale à 1 500 euros est à saluer : il améliore la situation de beaucoup de personnes en matière de pension.
Mais cela ne suffira toujours pas à payer vos propres soins plus tard dans votre vie. Il faut faire plus pour cela, d’autant plus que le nombre de propriétaires diminue fortement et que tout le monde ne pourra pas compter sur la valeur de sa propre maison comme tampon financier supplémentaire.

Philip Neyt suit de près les questions relatives aux pensions depuis des décennies. Il a notamment été PDG du fonds de pension Belgacom et président de Pensioplus, l’association des institutions de retraite.
MB